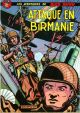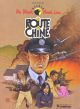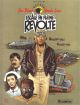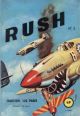Les Tigres Volants
| LES TIGRES VOLANTS | |
| Scénariste | Félix Molinari |
| Dessinateurs | Félix Molinari, Aurelio Bevia, |
| Éditeur | Impéria |

| |
Les Tigres Volants Série française de guerre créée en 1972 par Félix Molinari pour l'éditeur Impéria et parue dans la revue Tora.
Sommaire
L'histoire
La série Impéria
La figure historique de Claire Lee Chennault est présente dans plusieurs épisodes, mais les personnages récurrents sont fictifs, même si leurs noms sont inspirés de ceux de certains pilotes emblématiques de l'unité.
Quelques exemples :
- Bob Neal, inspiré de Robert H. Neale (1914 - 1994), officiellement le meilleur as de l'unité avec 13 victoires confirmées (victoire = 1 avion ennemi abattu), commandant de la première escadrille,
- Tex Hill, inspiré de David Lee "Tex" Hill (1915 - 2007), qui deviendra le commandant de la seconde escadrille, et finira la guerre avec un compteur de 18,25 victoires (le 0,25 étant dû à une victoire partagée avec trois autre pilotes),
- Parker Dupoy, inspiré de Parker S. DuPouy (1917 - 1994), crédité de seulement 3,5 victoires, mais qui, d'après les archives, aurait abattu 7 avions supplémentaires, décoré pour avoir percuté un chasseur ennemi car à court de munitions, et avoir pu ramener son appareil endommagé,
- Mac Garry, inspiré de William D. McGarry (1916 - 1990) , 8 victoires officielles au compteur, abattu et fait prisonnier par les japonais en mars 1942, il parvint à s'échapper en 1945 dans... un cercueil... !
Bizarrement, il n'est pas fait mention du plus célèbre d'entre eux, Gregory "Pappy" Boyington (1912 - 1988), futur commandant de la VMF-214, le "Black Sheep Squadron", popularisé par la série connue en France sous le titre Les Têtes Brûlées, d'autant qu'elle fut diffusée à la télévision française à partir de mars 1977, donc contemporaine à la parution de Tora en kiosques.
Comme pour les Chance Vought F4U "Corsair" des "Têtes Brûlées", les "Tigres Volants" étaient reconnaissables à leur monture, l'unité utilisant exclusivement des Curtiss P-40. Ce que l'on peut voir dans la série Impéria. Malheureusement, la version dessinée dans les récits est ultérieure à celle réellement employée en combat. L'appareil est équipé de deux paires de trois mitrailleuses par aile, ce qui le rapproche temporellement à la version E. Or, la version des "Tigres Volants" en 1941 était bien identifiable avec ses deux mitrailleuses par aile et ses deux supplémentaires sur le capot moteur. En fait, les appareils que Chennault avait pu récupérer provenaient d'une série produite pour la Royal Air Force basée en Afrique du Nord, désignée "Tomahawk" IIB (ou P40C dans l'armée américaine), voire P-40B / "Tomahawk" IIA visuellement très similaires, puisque l'avionneur Curtiss avait utilisé des composants encore en stock de cette version antérieure. Seul Rino Ferrari, parmi les 77 couvertures qu'il a peintes pour cette série (reliures comprises, hors rééditions), a pris en compte cet aspect dans certaines de ses illustrations (Nos 4, 8, 12, 16, 27, 49 ; albums 1 et 3), Félix Molinari ayant complètement omis cette particularité. L'unité recevra bien quelques P-40E, mais vers avril 1942, quelques semaines avant sa dissolution.

| |
| Un Curtiss P-40B préservé | |
Pour rester dans les avions, la série montre régulièrement des combats entre les P-40 et les fameux Mitsubishi A6M "Zero". Les "Tigres Volants" n'ont jamais rencontré ce redoutable adversaire. Le chasseur nippon qu'ils ont le plus fréquemment rencontré était le Nakajima Ki-27 à train fixe, et, plus rarement, le Nakajima Ki-43 plus moderne que les américains confondaient avec le "Zero".
L'unité des "Tigres Volants"
Le Japon dispose d'une industrie aéronautique qui suit au plus près les progrès techniques et les innovations de l'aviation, et ce dans un pays qui, à l'instar de l'Allemagne, voit se développer un important complexe militaro-industriel pour accompagner sa politique d'expansionnisme qui a démarré avec l'annexion de la Corée en 1910.
La Chine par contre dépendait essentiellement de l'aide et du matériel de l'extérieur, achetant ce qu'on voulait bien lui vendre. Ainsi, à partir de 1937, lorsque le pays est attaqué, son parc de chasseurs est assez hétéroclite, comprenant une douzaine de Breda Ba.27 et à peine plus de Fiat CR.32 italiens, un peu plus d'une trentaine de Gloster "Gladiator" britanniques, une cinquantaine de Curtiss "Hawk" II et une centaine de Curtiss "Hawk" III ainsi qu'une dizaine de Boeing P-26 américains, et même une vingtaine de Dewoitine D.510 français. Mais la majorité des chasseurs chinois provenait de l'Union Soviétique qui fournira plus de 560 appareils Polikarpov I-15 bis, I-152, I-153 et I-16, la plupart pilotés par des russes (environ 200 pilotes soviétiques périront en Chine entre 1937 et 1939).

| |
| Claire Lee Chennault (1893 - 1958) | |
C'est aussi en 1937 que Claire Lee Chennault (1893 - 1958), qui vient de mettre fin à sa carrière d'officier de l'Armée de l'air américaine, devient conseiller à l'aviation de Tchang Kaï-chek, chef du gouvernement et de l'armée chinoise qui tente de s'opposer à l'invasion japonaise, cette dernière fortement appuyée par l'aviation, notamment via des bombardements intensifs de villes chinoises qui font des ravages dans la population civile. Chennault va grandement organiser l'aviation nationaliste, s'appuyant sur le modèle américain. Dans le même esprit, il souhaite obtenir l'appui de son pays et créer des unités de pilotes et techniciens américains débauchés des unités des Marines, de la Navy, et de l'U.S. Army Air Corps, puisque les États-Unis sont officiellement neutres.
Durant l'hiver 1940-41, Chennault, via une société militaire privée nommée la Central Aircraft Manufacturing Company (CAMCO), va recruter une centaine de pilotes et le double de mécaniciens, ainsi qu'une dizaine d'instructeurs, tandis qu'il parviendra à acquérir une centaine d'appareils Curtiss P-40. Le personnel ainsi recruté aura le statut de volontaire, d'où l'appellation officielle de l'unité de First American Volunteer Group (Premier Groupe de Volontaires Américains), donnant une image plus positive que son statut réel de mercenariat.
Ceci dit, l'opération se monta avec l'assentiment du président américain Franklin D. Roosevelt, même si aucun ordre ni aucune directive écrite n'ont été signés officiellement de sa main.
La mise en place de l'unité fut longue car outre les problèmes de logistique, les difficultés pour remonter les avions livrés en caisse à Rangoon en Birmanie, les équiper (ils ont été livrés sans armes ni radios et viseurs), il fallut former les pilotes dont beaucoup avaient exagéré leur expérience en vol, certains n'ayant jamais piloté de chasseur, attirés par le salaire et la prime promise par avion adverse détruit (en vol ou au sol). Certains seront d'ailleurs réaffectés à des tâches administratives ou techniques. La difficulté d'approvisionnement en pièces détachées, obligeant au système D et à la récupération sur des avions trop endommagés pour revoler, sera un problème constant, et l'unité n'aura jamais plus d'une soixantaine d'appareils opérationnels en même temps.
Mais en avril 1941 un pacte nippo-soviétique de non-agression est signé, ce qui entraîne la fin de l'aide russe. Cela précipita la mise en route opérationnelle de l'unité. Celle-ci sera formée de trois escadrilles, nommées "Adam & Eve" (1st Squadron), "Panda Bears" (2nd Squadron) et "Hell's Angels" (3rd Squadron), chacune avec leur insigne dédié. Mais le signe distinctif visible sur les avions et qui participera à la légende sera l'énorme gueule de requin peinte sur le nez des appareils, après que des pilotes aient vu pareille décoration sur des P-40 "Tomahawk" du Squadron 112 de la Royal Air Force qui combattait alors en Afrique du Nord. Une pratique que l'on reverra régulièrement sur ce type d'avion dans d'autres unités.

| |
| La fameuse "gueule de requin" de l'unité | |
L'unité sera surnommée les "Flying Tigers" par la China Defense Supplies, principale agence de coordination de l'aide en prêt-bail à la Chine depuis les États-Unis, située à Washington, qui demande aux studios Disney de créer un emblème caractéristique, dont un des dessinateurs propose un tigre du Bengale avec des ailes.

| |
| L'insigne Disney | |
Contrairement à une légende tenace, si le groupe fut décidé et créé avant le 7 décembre 1941, il ne combattit pas avant l'attaque de Pearl Harbor et l'entrée en guerre officielle des États-Unis. La première rencontre avec l'ennemi est datée du 20 décembre suivant, lorsque des pilotes des "Adam & Eve" et "Panda Bears" sont envoyés intercepter des bombardiers qui pilonnent depuis plusieurs raids la ville chinoise de Kunming quasiment en toute impunité. Non seulement le raid va échouer, mais neuf des dix bombardiers engagés ne rentreront pas. L'unité va ensuite participer à la défense de Rangoon en Birmanie (de nos jours renommée Yangon) jusqu'à sa chute en mars 1942. Une défaite qui va contraindre les "Tigres" de reculer sur diverses bases de Chine, parfois bombardées, ce qui ne les empêche pas de malmener l'aviation japonaise.
Mais la pression des autorités militaires américaines et chinoises est de plus en plus forte, exigeant de Chennault des missions de soutien et d'attaques au sol afin de montrer aux soldats chinois en déroute qu'ils étaient protégés. Des missions dangereuses menées par des pilotes et des appareils fatigués. Bien que contestées, mais parfois aussi indispensables, les volontaires vont s'appliquer à remplir ces missions, qui forceront régulièrement l'envahisseur à marquer le pas, permettant à l'armée chinoise de gagner du temps en attendant les renforts alliés.
Le 1er juin 1942, les premières unités américaines commencent à arriver sur le théâtre d'opération. Commencent alors des négociations pour intégrer les "Flying Tigers" dans l'armée américaine. Mais fatigués et démoralisés par l'attente vaine de nouveaux équipements promis par celle-ci, sans parler de la pression mal vécue de l'Army Air force pour leur imposer des missions, la grande majorité des pilotes refusèrent et démissionnèrent, et le 4 juillet 1942, l'American Volunteer Group cessa d'exister. Le jour-même de la dissolution, lors de son dernier combat, l'unité descendit encore quatre avions ennemis.
Entre le 20 décembre 1941 et ce 4 juillet, le bilan des "Flying Tigers" est officiellement de 297 avions ennemis détruits, dont 229 dans les airs. Et ce pour la perte de 14 pilotes tués ou faits prisonniers : 5 morts en combat aérien, 5 autres lors d'attaques au sol, 4 abattus mais capturés lors de ces mêmes attaques (1 seul mourra en captivité). À ces pertes il faut ajouter 7 autres pilotes tués lors d'accidents ou de raids aériens. Durant cette épopée, 19 pilotes deviendront des as (soit au moins 5 victoires aériennes reconnues).

|
La renommée des "Flying Tigers" fut telle qu'un film de propagande fut mis en chantier par Republic Pictures dès fin avril 1942 aux États-Unis, tourné en moins de deux mois, réalisé par David Miller, avec John Wayne en rôle principal. Complètement fantaisiste, le film Flying Tigers sort sur les écrans le 8 octobre de la même année, et reçoit trois nominations aux Oscar de 1943 (meilleur son, meilleur effets spéciaux et meilleure musique) sans toutefois remporter une statuette. Le film sera l'un des succès de l'année, et même le plus gros alors enregistré par le studio Republic qui envisagea une suite qui ne verra néanmoins pas le jour. Il est connu en France sous le titre Les Tigres Volants, sortant dans nos salles le 6 juillet 1949.

|
Une autre production cinématographique, financée par la 20th Century Fox, tourné en un peu plus de deux mois, exploitant l'aura romantique des "Flying Tigers" pour des aventures rocambolesques et propagandistes, sort sur les écrans américain le 9 décembre 1942. Il s'agit du film China Girl d'Henry Hathaway, avec Gene Tierney et George Montgomery. Si l'histoire du film se déroule en partie à Mandalay en Birmanie, où est sensée être basée l'escadrille des "Tigres volants", il n'y a pas de combats aériens et on y voit très peu d'avions, dont un P-40 maquillé à la fin. Le film est connu en France sous le titre La Pagode en flammes où il est sorti en salles le 1er juin 1949.
En 1992, peu avant le cinquantième anniversaire de la dissolution du groupe, ses membres sont tous reconnus, de manière rétroactive, comme vétérans de l'armée de l'air américaine. En 1996, les survivants sont décorés de la Distinguished Flying Cross (pour les pilotes) ou de la Bronze Star (pour le personnel au sol).Les "Tigres Volants" dans la bande dessinée francophone
Sept ans plus tard, le créateur de la série Les Tigres Volants, Félix Molinari, reprend le thème pour une parution en album cartonné au sein des éditions Soleil, sur des scénarios de Richard D. Nolane. Aucune référence n'est toutefois faite à la série parue aux éditions Impéria, et tous les personnages principaux sont modifiés, très probablement pour éviter des problèmes de droits avec le patron de celles-ci, Robert Bagage, qui avaient empêché une éventuelle reprise de Garry.
Le premier tome sort en février 1994, et quatre autres suivront. Molinari y fait montre d'un peu plus de sérieux dans le graphisme des matériels d'époque, même si le récit reste fictionnel. Le manque de succès amènera l'arrêt de la série en 2000.
Titres des albums :
- Raids sur Rangoon (02/1994),
- Mission à Singapour (04/1995),
- Tonnerre sur le Yang Tse (03/1996),
- Étoile rouge (11/1998),
- Opération "Homme de Pékin" (06/2000).
On notera que les "Tigres Volants" avaient déjà fait leur apparition dans la bande dessinée francophone avec le héros Buck Danny qui se voit muté dans l'unité au troisième album de ses aventures, La Revanche des Fils du Ciel, paru en 1950, où il rencontrera ses futurs habituels comparses Jerry Tumbler et Sonny Tuckson. Le pilote vivra donc ses aventures durant le reste de la Seconde Guerre mondiale comme membre de cette unité, celle-ci étant alors intégrée dans la China Air Task Force de l'United States Army Air Forces (USAAF).
Ils sont aussi les protagonistes du premier tome de la série L'Escadrille des Têtes Brûlées paru en octobre 2010 chez Zéphyr Éditions.
Liens externes
- Article Wikipédia sur l'unité
- Article Wikipédia sur l'unité (texte en anglais)
- Le site officiel de l'AVG Flying Tigers Association (texte en anglais)
- Fiche IMDb du film Flying Tigers (texte en anglais)
- Fiche IMDb du film China Girl (texte en anglais)
Auteur de l'article
- Pak : création et rédaction